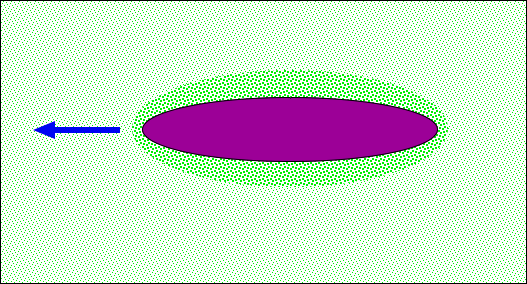Pour
démarrer à vélo, il faut fournir une certaine
énergie. Ensuite, il faut continuer à pédaler pour
compenser les frottements qui dissipent une certaine quantité
d'énergie. Passer d'une vitesse à une autre plus
importante stocke une part d'énergie qu'il faut fournir à
la masse que l'on déplace. Une voiture lourdement chargée
n'est pas nerveuse, elle mets plus de temps à
accélérer, le moteur doit fournir une plus grande
quantité d'énergie que si elle était faiblement
chargée. On conçoit donc facilement qu'un objet mobile en
déplacement uniforme contient une certaine énergie
potentielle liée à la masse en mouvement. Et quand cet
objet tape dans un mur, plus il est lourd et plus il est rapide, plus
le trou qu'il fait dans le mur est gros. Au moment de l'impact,
l'énergie se dissipe sous forme mécanique, l'objet se
ratatine et le mur s'émiette. Plus pour un gros camion que pour
une voiture légère. La représentation de
l'énergie inertielle est donc aisée.
S'il n'y avait
pas de frottements des pneus sur le sol, de la carrosserie dans l'air,
et pas d'énergie dissipée par les frottements
mécaniques dans les roulements à bille, un
véhicule une fois lancé sur une route plate ne
s'arrêterait pas, il continuerait sur sa lancée. Cela
permet d'imaginer le mouvement régulier uniforme. Un objet se
déplace en ligne droite à une certaine vitesse, pour
qu'il aille plus vite il faut lui fournir de l'énergie, pour le
freiner l'objet doit rendre de l'énergie et en
général c'est en dissipant de la chaleur dans les freins. Pour
accélérer ou pour le freiner une fusée dans l'espace à partir d'un
mouvement rectiligne uniforme, il faut fournir de l'énergie.
Nous
pouvons maintenant tenter de représenter ce qu'est l'inertie,
cette faculté d'un objet à conserver sa façon de
bouger régulièrement par rapport à son
environnement liée. L'inertie est liée à la masse,
que l'on associe à un énergie nécessaire à
un mouvement régulier uniforme dans un référentiel
donné. Comme image nous prendrons une barque catalane pointue
à l'avant et à l'arrière. Imaginons qu'elle ait un
mouvement uniforme régulier dans un lac recouvert de roseaux.
L'avant de la barque écarte les roseau. Il faut une certaine
quantité d'énergie pour les écarter, un roseau est
élastique, il plie mais ne romps point. Les roseaux glissent le
long de la barque, et derrière les roseaux revenant à
leur position initiale redonnent l'énergie qu'ils avaient
accumulé en eux. La barque perd à l'avant
l'énergie qu'elle récupère à
l'arrière. Nous faisons pour cette vision idéale la
représentation d'un monde sans frottement afin de conserver une
vitesse constante à la barque, ce qui est une petite entorse par
rapport au monde réel, car en réalité le
frottement des roseaux le long de la barque ainsi que celui de la
barque dans l'eau et dans l'air finissent par absorber l'énergie
inertielle de cette dernière qui s'immobilise alors au milieu
des roseaux. Mais restons sur cette image idéale d'une barque
dans un monde sans frottement, afin de garder cette notion de cycle de
l'énergie, de l'avant de la barque aux roseaux, et des roseaux
à l'arrière de la barque.
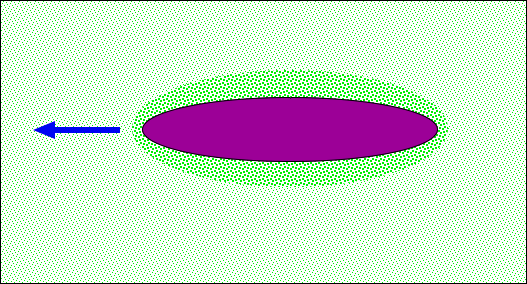
Les roseaux occupant l'espace pris par la barque glissent le long du bord.

A l'arrêt, les roseaux entourent la barque.
Faisons maintenant
mentalement la transposition de la barque vers un bloc de
matière, et des roseaux vers la structure en gelée de
l'Univers. La matière est traversée par la structure car
celle-ci est omni-présente, aussi bien dans l'espace vide que
dans la matière. La matière déforme la structure
par le biais de la gravité, qui est fonction de la masse de la
matière. Cette déformation constitue un travail
mécanique, un stockage de l'énergie. La structure est
mise localement sous tension par la gravité. Considérons
donc une sphère de matière telle une planète se
déplaçant dans l'espace à vitesse constante par
rapport à la structure gelifère de l'Univers. Au fur et
à mesure de l'avancement de la planète la gravité
due à la masse de cet objet céleste va mettre sous
tension localement la structure, celle-ci va accumuler une certaine
quantité d'énergie qui sera rendu après le passage
de la planète par rapport à la structure. Au fur et
à mesure et constamment, il y a un cycle de l'énergie qui
est régulier, uniquement fonction pour une planète
considérée de sa vitesse par rapport à la
structure. Le mouvement relatif est stabilisé. La
quantité d'énergie mise en jeu est invariante pour un
mouvement relatif régulier. Tant que l'on n'apporte pas
d'énergie supplémentaire ou que l'on n'en dissipe pas la
planète continue son mouvement d'avancée
régulière.

Nous posons donc que la matière
traverse sans frottement la structure gelifère, et que le
passage de la matière ajoute une tension supplémentaire
dans la structure gelifère qui est relâchée
intégralement après le passage. Nous disposons alors
à l'aide de la structure gelifère d'une
représentation mentale du déplacement inertiel
régulier dans un référentiel donné relatif
ou absolu. Le mouvement de la matière par rapport à la
structure gelifère est relatif si on fait abstraction du reste
de la matière de l'univers, c'est soit la matière qui
avance par rapport à la structure, soit la structure qui se
déplace par rapport à la matière, soit l'un qui
vient à la rencontre de l'autre. L'observateur peut adopter les
trois points de vue, le sens que l'on attache à cette
représentation mentale ne varie pas quel que soit le
référentiel adopté.
Se
pose alors le cas particulier du volant d'inertie. Si l'image de la
barque traversant des roseaux permet de passer d'une représentation 3D
toujours délicate à représenter à une vision somme toute basique, elle
permet alors par réduction d'illustrer et d'explicité la force
centrifuge liée à un effet rotationnel.
On considère la barque
reliée à un piquet et tournant en rond. Les roseaux n'affectent alors
que l'un des bords, et donc exercent dessus une pression que rien ne
vient contrebalancer de l'autre bord. On a alors l'explication de la
réalité de la force centrifuge. Plus grand est le nombre de roseaux
dans un intervalle de temps donné agissant sur le bord, plus grande est
la force. Étant donné que la réalité concerne un volume, dans le cadre
d'un tore tournant autour d'un point fixe, cette force est
proportionnelle à ce volume, multiplié par la distance du rayon et la
vitesse de rotation. L'inertie est donc bien une mesure de longueur à
la puissance quatre, ce qui est communément admis par l'ensemble des
physiciens.
Une conséquence directe est alors que la rotation
altère la gravité en tendant les brins de la structure gélifiée de
l'espace, car la vitesse de passage de la matière au travers des brins
ne peut se faire qu'en tenant compte de la résistance de l'une par
rapport aux autres, et ce à une vitesse inférieure à c. C'est l'effet Lense-Thirring déjà répertorié.