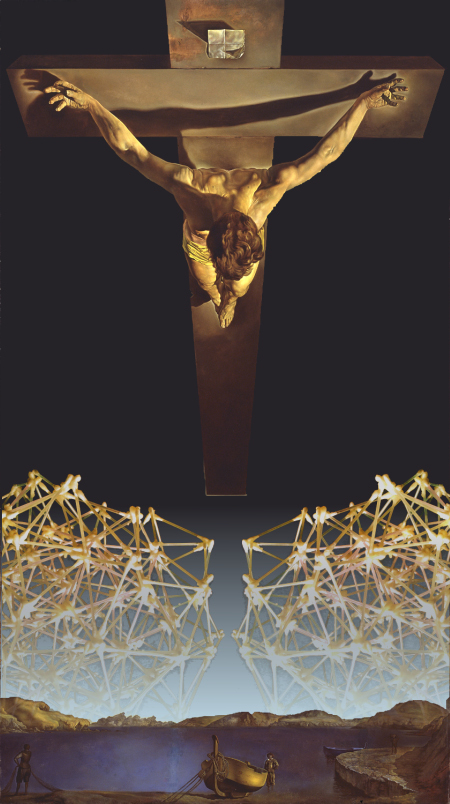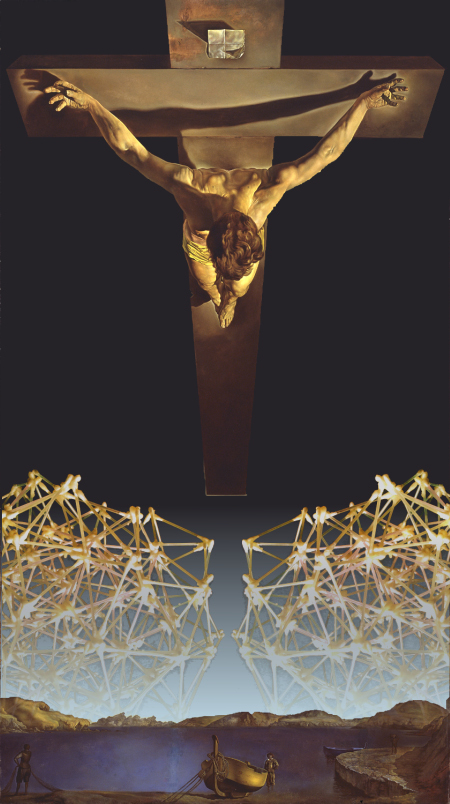Au
début était le Verbe, Il dit « Aime
Toi. », avec toute l'ambiguïté due au contexte.
Il n'y avait que le vide pour accueillir cette parole. Le vide vibra du
point blanc d'où avait jaillit la parole et se mit en branle. Il
tournoya, ploya sous le charme de l'irruption du premier mot, et ce
vide en mouvement fut appelé gelée primordiale, produit
par le premier mot sur le vide. L'action du Verbe était donc
mouvement. Il fallut que ce premier mot fasse la jonction avec la
deuxième. Le « Toi » désignait
l'Autre, l'altérité. Où pouvait-elle cette
différence se situer ailleurs qu'à l'extérieur,
à la périphérie du vide ? La gelée explosa
pour obéir à l'articulation de la parole et faire la
jonction entre les deux termes. En réaction à cet
explosion primordiale, le vide central se contracta, forma un point de
taille nulle et de compression absolue. Il est symbolisé par le
point final à la parole première. Il explosa à son
tour sous cette contrainte absolue, et quinze milliards d'années
plus tard, cette singularité fut appelée Big-Bang,
entraînant toute la cosmologie dans son sillage.
Ainsi se
définit la nature de l'Histoire. Des éléments
primordiaux qui lui ont donné naissance, nous avons l'histoire
du Verbe, le cadre où cette histoire s'inscrivit, et la
façon dont elle le construisit. Le vide par essence était
vide. Le néant, rien, nada. Pas même un pet de lapin. Un
lieu inexistant, sans histoire, éternel, existant avant et
après la fin des temps, inconcevable, mais représentable
en vidant quelque chose de tout ce qu'il peut être. Bien peinard,
le vide initial existait sans avoir la moindre existence. Il ne fut
révélé dans l'histoire que par l'action de la
parole. La parole le désigna implicitement comme cadre et comme
support. La parole ne pouvait exister que par une absence initiale
totalement indéfinie, sans nature, indéfinissable, la
quintessence du rien, un point inexistant au début de la phrase,
un point blanc donc invisible. Un pur objet imaginaire inexistant et
inconcevable, irreprésentable évoquable seulement par
l'usage des mots. En mathématique, le point blanc n'est pas
évoqué. Impossible d'en faire la trace.
Le point
noir, tâche sur la feuille blanche, image du contraste entre ce
qui est et ce qui n'est pas est représenté par
zéro. Il acquiert par rapport au point blanc une
représentation. Un point noir qui s'agrandit et que l'on vide
à l'intérieur ressemblant comme deux gouttes d'eau
à la lettre « O ». Une trace qui indique
seulement que cette griffure est inexistante en tant qu'essence,
circonscrite uniquement par le verbe qui en parle et la trace graphique
qui l'indique, et qui la représente en l'agrandissant par la
graphie d'un cercle. Le zéro est donc un pur artifice de la
représentation, mais qui correspond à la
représentation du vide, degré zéro de l'espace. On
peut ainsi placer autant de vide que l'on veut dans un certain espace,
cet espace restera toujours aussi vide. De même on peut
additionner autant de zéro à un chiffre, on aura juste
répété plusieurs fois l'opération 1 + 0 = 1
En
remontant à l'ultime, on peut dessiner autant de points blancs
sur une feuille blanche, on ne verra rien, et rien ne permettra de
dénombrer le nombre de points blancs tracés sur une
feuille blanche. C'est absolument indéfinissable, et c'est
à partir de cette base que nous pouvons complexifier notre
modèle initial et décrire le monde qui nous entoure en
tant qu'esprit humain.
Traduire, c'est effectuer
l'opération de passer d'un système de
représentation à un autre en conservant l'essence de la
description, c'est à dire la représentation qu'une
personne obtient dans sa vision des choses, des idées et des
concepts. Arriver à parler du vide dans deux systèmes de
représentation différents en conservant un sens commun
que l'on peut écrire « rien=zéro »
applicable à la notion de vide version physique, et
également à un système de représentation
mathématique qui permet la généralisation de ce
concept à l'ensemble du monde physique. Nous avons alors
à notre disposition le moyen qui nous permet de joindre des
objets disparates quelconques par un lien relationnel direct. Il y a
correspondance bi-univoque entre notre dire et l'objet du réel
dont nous parlons. C'est l'explication à l'interrogation du
pourquoi nous pouvons décrire le réel à partir de
la Mathématique. Nous disposons ainsi du point d'ancrage de la
passerelle qui lie la carte au territoire par un point de passage
minimaliste irréductible. Plus inconcevable que le point blanc,
cela ne peut. Plus inexistant que le point noir cela n'est. Point blanc
puis point noir constituent la base de la géométrie, le
point noir en se déplaçant linéairement dessine
une droite. Et par dessus toute la géométrie se construit.
Moins
que le vide n'existe pas. Car le vide n'est pas existant, c'est une
qualité qu'il ne possède pas, il n'en dispose d'aucune,
il ne peut être qu'habillé par un désir externe. Le
vide n'est donc qu'une utilité introduite selon la
nécessité de l'histoire, le déroulement de cette
dernière lui prêtant une existence qu'il ne possède
pas, et tout à la fin, le conteur révèle que ce
que l'on a habillé et maquillé de milles artifices se
trouvait investit d'une réalité dont l'essence
était de n'être pas. Mais de ce fait, il constituait le
vide initial assigné à jouer un rôle, celui de
supporter la représentation.
Le scénario
initial, la parole dans le vide se concrétisa par de la
gelée, du vide en mouvement, le vide initial qui par nature si
l'on peut dire était de rester vide, et toute la cosmologie ne
constituait que la conséquence de la partie seconde de cette
irruption.
Le vide en
mouvement se cristallisa en gelée. Une spécificité
étant ajoutée au vide, celui ci ne l'était plus.
Le vide en mouvement par rapport au vide étant un nouvel
état par rapport au degré zéro que
représente le vide. La complexité venait de franchir sa
première étape. La nature comptait le vide, ce qui
était équivalent à zéro, et le vide en
mouvement, la gelée du vide, ce qui permettait de
définir un état nouveau, neuf, conséquence directe
de l'irruption de la parole dans le néant. Il convient alors de
définir et de reconnaître qu'à ce niveau les deux
termes sont équivalents, le devenir du vide et de la
gelée du vide. La gelée en s'expansant occupe un espace.
Elle meuble le vide. En s'expansant, elle crée l'espace.
L'espace que nous appréhendons en tant qu'humains, dans lequel
nous vivons, est formé de la superposition du vide et de sa
gelée. Pas facile à expliquer la cuisine primordiale.
Celle qui conditionne la soupe dont nous sommes issus, Nous humains,
descendons de cet instant primordial, conglomérat d'atomes issus
des étoiles et de la part d'interrogation quand à notre
origine. Nous nous inscrivons dans le droit fil de l'émergence
du Verbe dans le vide. Nous en sommes la conséquence ultime dans
le sens ou nous pouvons nous interroger quand à notre origine.
Cela signifie que la boucle est complète, que nous arrivons
à remonter jusqu'à notre point de départ, et que
nous avons la faculté de comprendre et mettre en forme la boucle
complète. Non pas que cela signifie que notre statut soit
circulaire, ce qui impliquerait que nous compterions pour zéro,
mais que nous avons à creuser du coté de la parole
initiale pour conquérir notre identité.
La
gelée en rotation forma un tore, car le centre de ce dernier est
vide, simple anneau dont la demie peau externe tourna dans un sens, la
peau interne dans l'autre de telle façon à l'ensemble
soit de vitesse relative nulle, et lancée à la recherche
de l'altérité externe forma un tube. Ce dernier se
fragmenta en une infinité de petits tuyaux sous la secousse du
Big-Bang qui cristallisèrent en un cristal à structure
triédrique, formant ainsi l'espace.
Avant le
début il y avait le silence de la parole s'exprimant dans le
vide, il n'y avait que le désir du Verbe qui décida de
parler, créant par sa puissance poétique le cadre de
l'espace, formé du vide primordial et de sa forme
gélifiée, et la violente réaction à la
gelé en partance généra le Big-Bang.
Le
mécanisme primordial est hors de portée de nos
expériences physiques. Nous ne pouvons calculer avec un temps
négatif, nous ne pouvons encore moins calculer avec un temps
absent. La seule représentation ne peut alors que s'appuyer sur
une logique formelle, qui permette de générer l'ensemble.
C'est le scénario de notre Histoire à son tout
début, d'où découle notre aventure dans l'espace
temps et qui permet de comprendre le pourquoi, sans s'approfondir sur
le comment. Seul le Verbe créateur peut confirmer ou infirmer la
chose.
Avec la notion de vide absolument vide, on ne peut rien
concevoir, ni support pour la lumière et les ondes
électromagnétiques, rien qui puisse le mesurer et le
définir, il faut pour calculer les distances introduire
l'espace, introduire ce support, qui soit mesurable en unité de
petits tubes de gelée mis bout à bout, et que l'ensemble
de cette gelée puisse être la structure cristalline
transmettant d'un point à un autre les diverses vibrations et
ondes qui nous environnent. La partie du vide en rotation
acquiert une qualité qui par réaction à sa
sollicitation permet d'introduire un coefficient de raideur qui
autorise cette propagation. La résistance à la
déformation de la gelée, donc du support de l'espace
introduit le temps par la fréquence de résonance sous une
contrainte donnée. Espace et temps sont donc liés par un
rapport simple lié à la raideur de la gelée.

En
empilant un ensemble de cube les uns sur les autres on peut
définir un espace stable et défini. La figure de base est
donc constitué de quatre segments de droites formant
carré et répété quatre fois. Si l'on essaie
de remplir l'espace avec trois segments seulement, on constatera qu'il
y aura un vide dans la figure construite par empilement. L'espace ne
pourra être totalement comblé qu'en jouant alors sur une
variabilité de la taille des segments, certains devront
être un peu plus grands que d'autres. Au lieu d'avoir des
longueurs rigides, en jouant avec une petite déformation
variable dans le temps, on peut considérer le modèle
formé de triangles équilatéraux comme plus
économe que le modèle formé à base de
carré, de quatre à trois, à condition d'introduire
une fréquence sur la longueur telle que le temps que l'on prenne
la mesure, la longueur du segment soit à la bonne dimension. On
introduit alors une erreur sur la mesure telle que si elle rentre dans
les bornes fixées, elle soit considérée comme
valable. Mais nous sommes alors passés d'une structure rigide
à une structure suffisamment souple pour remplir l'espace et
disposant d'une fréquence de base pour lui permettre par
oscillation d'être considérée comme
complète. Un simple petit défaut de
géométrie introduit la possibilité de superposer
à une fréquence d'autres fréquences, et de
transmettre alors d'un bout à l'autre de la structure de
l'espace n'importe quelle oscillation ou onde, donc d'énergie.

Pour parfaire le travail de représentation de cette Mythologie
et relier les différents élements du puzzle qui
constituent les d'images qui structurent notre perception du
réel et notre cadre de vie intelectuel, j'ai comblé la
surface vide par l'image de ce qu'elle est sensée
représenter dans le réel. J'ai rajouté un trou
noir sous le pied de l'ange, évidement il n'arrive pas à
être l'aspirer, c'est un peu la symbolique du mal. Pour Adam,
appuyé sur la matière, il la comprime, et la
gravité déforme la structure les cellules qui la
composent sont donc comprimées.
Le regard d'Adam se porte sur la structure, donc sur la matière,
il ne voit pas Dieu. Il le suppose, c'est la raison de son bras
alanguis. Dieu lui est plus franc et plus direct, il pointe et regarde,
il voit Adam mais ne le touche pas. C'est donc l'espace qui sert de
médium entre les deux parties en présence. C'est la
distance qui fait joint et c'est là tout le paradoxe. Tout
vibre, l'espace et la matière mais on ne le perçoit pas.
Vincent Van Gogh a réussi a le rendre par la peinture. On peut
le constater en regardant un champ de blé ployant sous le vent
qui révèle le caractère roulant et vibrant du
vent. Je ne peux donc pas me servir de sa peinture pour rajouter une
structure gélifiée car on en voit déjà les
effets. C'est par là que nous sommes saisis quand nous sommes en
présence d'une toile de son oeuvre. Le plus important n'est pas
visible, il est dans la recherche et l'imaginaire.

Les cellules tapissant le fond de l'oeil enregistrent
l'intensité et la variation des ondes
électromagnétiques visibles. Le cerveau peut alors
composer une image. Nous croyons voir le réel, alors que ce
n'est qu'une re-composition. Ce que nous pensons voir est noir, vide de
lumière, les ondes électo-magnétiques ne sont que
des phénomènes vibratoires de la structure
gélifiée du vide, et cette dernière est par
définition totalement transparente. C'est la raison pour
laquelle invisible, elle n'a pu être découverte par des
mesures physiques, il aurait fallut penser à priori qu'elle
existât.
C'est pourquoi le noir entourant le Christ de Salvador Dali est un
choix génial. Il est l'image même du vide, et participe
à la dramatisation de la scène. Le Christ est dans un
vide vide. Il est hors du réel, ressuscité, il appartient
à l'Histoire, mais n'est plus inscrit dans notre monde
qu'à la faveur de nos représentations. Et après
cette oeuvre de Salvador Dali, qu'on le veuille ou non, l'image du
Nazaréen est devenue immortelle. Nous savons que le mental des
humains est fondée sur la lecture des images imaginaires. Il
reste donc à intérioriser ce qui est du ressentis des
artistes immenses qui au-delà de leur habileté et de leur
rendu nous donnent à lire leur sensibilité et leur
croyance intime. Il y a, il y a eu, et il y aura. C'est le Verbe qui
règne sur les temps. Les canards aussi, je l'espère... ;-)